
À nous les expertises !
20 juin 2015
Plaidoirie en kit : les braconniers du droit.
15 décembre 2015Avocat, pour quoi ai-je juré ?
Je jure, comme Avocat, d’exercer mes fonctions avec dignité,
conscience, indépendance, probité et humanité.
Synthèse en cinq mots des qualités d’un Avocat et de l’essence même de notre déontologie professionnelle, le serment que prête aujourd’hui tout Avocat qui s’inscrit à un Barreau est issu de l’article 2 de la loi n°90-1259 du 31 décembre 1990.
Mais le serment de l’Avocat est bien plus ancien.
 Le principe d’un serment professionnel de l’Avocat remonte au droit romain. Dans le Code Justinien, l’Avocat devait jurer sur les Évangiles de ne rien négliger pour la défense de son client et de ne pas se charger d’une cause reconnue comme mauvaise.
Le principe d’un serment professionnel de l’Avocat remonte au droit romain. Dans le Code Justinien, l’Avocat devait jurer sur les Évangiles de ne rien négliger pour la défense de son client et de ne pas se charger d’une cause reconnue comme mauvaise.
La tradition du serment professionnel fût véritablement ancrée au Moyen-Age par une ordonnance de Philippe III Le Hardi du 12 octobre 1274 qui imposait à l’Avocat de prêter serment et lui conférait le titre de « Maître ».
La soumission à la religion y était consacrée : « Les avocats, tant de parlement que des bailliages et autres justices royales jureront en latin sur les Saints évangiles qu’ils ne se chargeront que des causes justes, et qu’ils défendront diligemment et fidèlement ; et qu’ils abandonneront dès qu’ils connaîtront qu’elles ne sont point justes … ».
Le serment a connu par la suite plusieurs modifications induites par la complexité des relations existant entre le Barreau et le pouvoir politique. Progressivement, à la dimension religieuse s’est adjointe l’allégeance au pouvoir politique.
Puis, les deux autorités se sont effacées au profit de vertus purement professionnelles et humaines.
- Ainsi, jusqu’à la Révolution, le serment avait une double dimension professionnelle et religieuse, à l’exclusion de toute référence au pouvoir politique.
- Après une parenthèse durant la Révolution au cours de laquelle les Barreaux ont été supprimés, la pratique du serment renaissait en 1804, mais cette fois-ci avec une connotation politique.
Au terme de la loi du 13 mars 1804 (article 31), l’Avocat jurait « de ne rien dire ou publier, comme défenseurs ou conseils, de contraire aux lois, aux règlements, aux bonnes mœurs, à la sûreté de l’État et à la paix publique, et de ne jamais s’écarter du respect, dû aux Tribunaux et aux autorités publiques ».
Napoléon voulait, selon sa propre expression, « couper la langue à un Avocat qui s’en sert contre le gouvernement ».
En 1810, le candidat au Barreau devait jurer « obéissance aux constitutions de l’Empire et fidélité à l’Empereur ».
En 1830, l’Avocat promettait « fidélité au Roi des Français ».
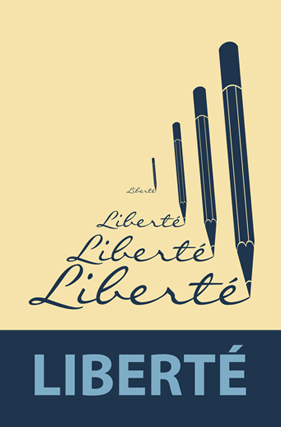 Pour la première fois en 1971, en plus d’exiger de l’Avocat le respect des lois et des bonnes mœurs, le texte du serment a fait mention de qualités humaines et professionnelles (article 23 du décret du 9 juin 1972).
Pour la première fois en 1971, en plus d’exiger de l’Avocat le respect des lois et des bonnes mœurs, le texte du serment a fait mention de qualités humaines et professionnelles (article 23 du décret du 9 juin 1972).
Le texte de 1804 devait désormais cohabiter avec des exigences inconnues jusque-là.
- L’actuel serment est dépourvu de tout caractère politique et ne comporte plus d’interdictions.
Notre serment ne fait en effet plus aucune référence à un quelconque respect constitutionnel ou à une autre forme de soumission graduée aux autorités publiques.
Sa formulation garantit la liberté de la défense et met l’accent sur les exigences de l’éthique professionnelle.
Ce serment est avant tout un serment professionnel : il manifeste l’engagement de l’impétrant qui a valeur d’obligation universelle pour toute parcelle de dossier à traiter par ses soins dans le futur.
Et c’est bien l’idée que l’on a de ce serment le jour de notre prestation (et encore aujourd’hui !).
Malgré ces évolutions, les propos du Chancelier d’Aguesseau, éminent juriste sous Louis XIV et Louis XV, dans L’indépendance de l’avocat n’ont pas perdu de leur modernité : « Vous êtes placés, pour le bien du public, entre le tumulte des passions humaines et le trône de la justice ; vous portez à ses pieds les vœux et les prières des peuples ; c’est par vous qu’ils reçoivent ses décisions et ses oracles ; vous êtes également redevables et aux juges et aux parties, et ce double engagement et le double principe de toutes vos obligations […]. Tel est le pouvoir de la vertu ».
Il n’y a cependant pas que l’Avocat qui prête serment, loin s’en faut.
En effet, bien plus de professions qu’on ne l’imagine prêtent serment, comme :
Le Commissaire Aux Comptes, qui s’engage à faire respecter les lois : « Je jure d’exercer ma profession avec honneur, probité et indépendance, de respecter et faire respecter les lois » (article L822-3 du Code de Commerce).
Le Conseiller Prud’homal, qui s’engage également à l’assiduité au travail (et il est le seul !) :« Je jure de remplir mes devoirs avec zèle et intégrité et de garder le secret des délibérations » (article D1442-13 du Code du Travail).
 Le Garde Champêtre ! Que j’ai eu le plaisir d’entendre « jurer » au détour d’une audience d’un Tribunal de Police : « Je jure de veiller à la conservation de toutes propriétés qui sont sous la loi publique et de celles dont la garde leur est confiée ».
Le Garde Champêtre ! Que j’ai eu le plaisir d’entendre « jurer » au détour d’une audience d’un Tribunal de Police : « Je jure de veiller à la conservation de toutes propriétés qui sont sous la loi publique et de celles dont la garde leur est confiée ».
Et connaissez-vous celui que nous sommes tous susceptibles de prêter un jour… ? Celui du témoin : « Je jure de parler sans haine et sans crainte, de dire toute la vérité, rien que la vérité » (article 331 du Code de Procédure Pénale).
Le serment, qui confère un pouvoir de dire et de faire sur la base de la confiance de la Société, a encore de beaux jours devant lui !
Et pour toutes ces raisons, j’ai juré, je jure et je jurerai encore.



